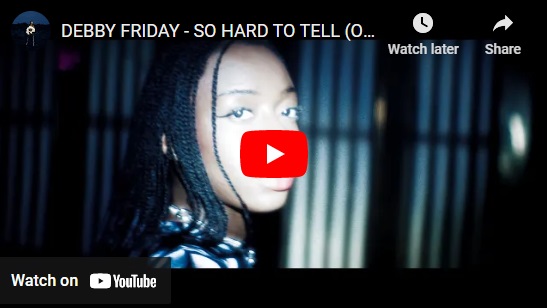Il y a de fortes chances que vous n’ayez jamais entendu un album canadien dans la même veine que Good Luck de Debby Friday. Ce premier album de la chanteuse et productrice nigériane établie à Toronto est une véritable poussée d’adrénaline de fusion musicale ultra moderne où s’entremêlent rave, rap, industriel, alternatif, R&B et hyperpop – pour ne nommer que quelques-uns des ingrédients. La biographie officielle de Firday la qualifie d’« antihéroïne zilléniale » et quand on lui demande comment elle qualifie son style musical, elle se contente de dire « hybride ».
Son histoire est à la fois typique de bien des jeunes canadiens de première génération et unique à son parcours et sa vision créative. Elle est d’abord arrivée à Montréal avec ses parents et elle a étudié dans une école catholique pour jeunes filles à Westmount avant de graduer dans la scène des clubs « after hours ». Plus jeune, elle rêvait de devenir auteure plutôt que musicienne.
« J’ai toujours été une enfant très créative » dit-elle au téléphone quelques jours avant le début de sa tournée européenne. « J’écrivais beaucoup quand j’étais jeune en me disant que je deviendrais peut-être auteure. Je n’avais toutefois pas la notion de faire carrière dans les arts parce que c’est simplement pas quelque chose qui faisait partie de la façon dont j’ai été élevée. Mes parents me soutiennent pleinement aujourd’hui, mais ils n’avaient simplement pas le contexte pour comprendre ce genre de travail ou d’industrie. On a beaucoup plus de choix, les jeunes de ma génération. On peut essentiellement créer notre propre carrière et c’est exactement ce que j’ai fait. »
Good Luck – paru chez Arts & Crafts au Canada et Sub Pop pour le reste du monde, nous arrive dans la foulée d’une série de simples et de EP qui ont cimenté la réputation de Debby Friday en tant qu’artiste à surveiller – carrément. Elle détient une maîtrise en beaux-arts et ses vidéoclips sont fortement influencés par ses études et sa passion pour l’art de raconter des histoires en images. Le clip de son simple « What a Man » fait référence à la tristement célèbre peinture du 17e siècle Judith tuant Holopherne d’Artemisia Gentileschi – l’une des seules artistes professionnelles de l’ère baroque en Italie. Elle a également lancé un court-métrage d’horreur surréaliste pour accompagner son album. Mais malgré tout cela, il n’y a pas un art qui se compare à la création d’une chanson, selon elle.
« Je crois que la musique est la forme d’art la plus rassembleuse parce que tu n’as pas besoin de parler la langue de la chanson », dit-elle. « En fait, une chanson n’a même pas besoin d’avoir des paroles pour que tu ressentes une connexion avec elle et avec les gens à travers elle. Des gens aux quatre coins de la planète peuvent ressentir la même chose quand ils entendent un morceau de musique. Je trouve ça absolument magnifique. »
L’artiste nous explique que pour son premier album, elle souhaitait faire passer son écriture et son talent de productrice à un niveau supérieur. « Avant, j’étais très à l’aise avec un seul mode d’expression, mais pour ce projet, je voulais être un peu plus ouverte et vulnérable. Je sentais en dedans de moi ce petit côté qui disait “OK, c’est le temps de faire les choses autrement. Il faut aller plus loin.” J’ai écouté cette voix intérieure et je l’ai suivie. »
Une partie de ce processus a consisté à travailler avec Graham Walsh, un membre du groupe électronique expérimental Holy Fuck qui a produit d’autres artistes comme Operators, Doomsquad, Sam Roberts Band et coécrit avec Lights. Friday, qui a l’habitude d’écrire, enregistrer, mixer et produire sa propre musique, a rencontré Walsh par l’entremise de son équipe de gérance et comme elle le dit, « il a tout compris du premier coup ». Son bouquet de 17 chansons – écrites majoritairement durant les confinements pandémiques – a été concentré pour devenir 10 petites pièces qui résument des décennies d’histoire de la musique électronique en 33 minutes de plaisir pop. On y retrouve des pièces parfaites pour les pistes de danse comme la très rythmée « I Got It » (avec Chris Vargas du groupe montréalais Pelada/Uńas) ou encore la sinueuse – et biblique – « Let You Down » qui explorent le côté sombre de l’âme, mais aussi des pièces comme la magnifique ballade « So Hard to Tell ».
Friday croit que cet aspect exploratoire de son art est le résultat direct d’avoir grandi à l’ère numérique. « On a accès à ce qui se résume essentiellement à une archive de toute la pensée humaine et toute l’histoire de la musique », affirme-t-elle. « Il ne reste plus qu’à choisir ce qui t’intéresse, ce qui marche pour toi. J’adore expérimenter. Je veux créer de jolies choses. On est rendu à un point dans l’histoire où tout est devenu autre chose – il n’y a plus nécessairement de contexte unique pour une chose donnée. C’est pour ça que j’appelle ma musique simplement un hybride. »